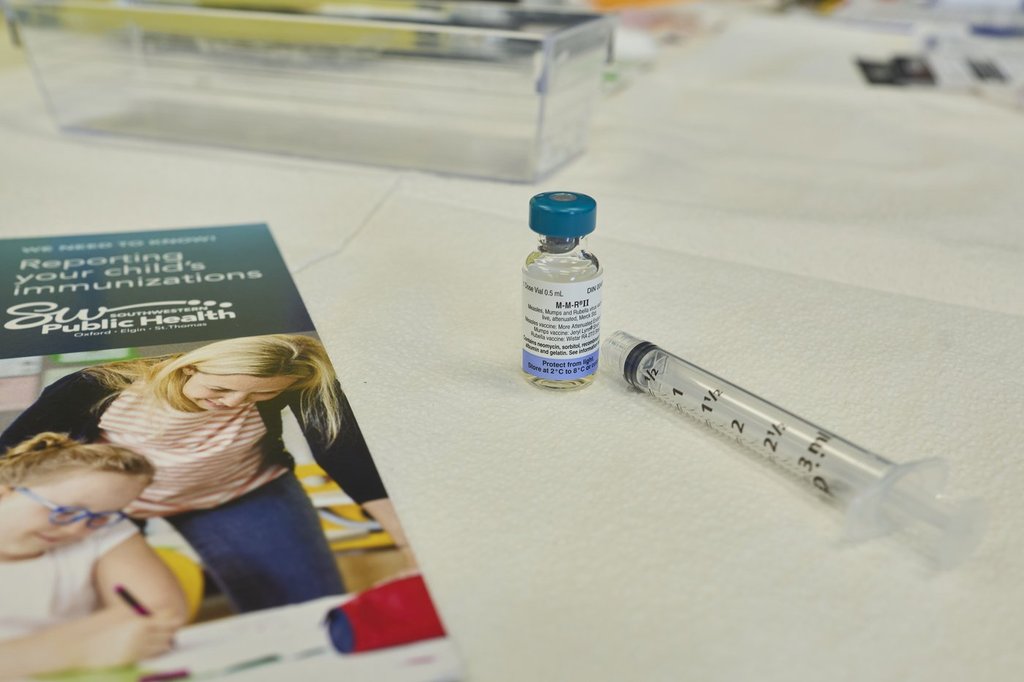Début du contenu principal.
Une éclosion de grippe aviaire dans le secteur de Saint-Jean-de-Matha
«Les oiseaux ont été abattus de façon humanitaire et sont éliminés pour éviter le risque de dissémination de la maladie.»

Une éclosion de grippe aviaire a été détectée dans le secteur de Saint-Jean-de-Matha, dans la région de Lanaudière, selon l’information disponible auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ce cas, un premier enregistré au Québec en 2025, a été répertorié à la fin janvier.
Cette épidémie a été confirmée dans une ferme de volaille commerciale.
Un porte-parole du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a ajouté auprès de Noovo info que le gouvernement du Québec «collabore avec tous les intervenants impliqués pour le retraçage des élevages en lien avec l’élevage positif et à proximité de celui-ci, afin d’appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de contrôle nécessaires pour limiter la propagation du virus».
Le MAPAQ précise que le processus d’intervention en pareille situation revient à l’ACIA. «Les oiseaux ont été abattus de façon humanitaire et sont éliminés pour éviter le risque de dissémination de la maladie», écrit le relationniste Yohan Dallaire Boily.
En février, le gouvernement fédéral a annoncé avoir acheté 500 000 doses de vaccin contre la grippe aviaire pour s'assurer que le Canada soit prêt à faire face à d'éventuelles menaces pour la santé.
Le Canada a signalé son premier cas humain de grippe aviaire – également connue sous le nom de H5N1 – contractée au pays le 9 novembre 2024. Une adolescente de 13 ans a été hospitalisée en Colombie-Britannique. Elle a été intubée et mise sous assistance vitale en novembre après avoir été infectée et a passé deux mois à l'hôpital avant d'en sortir. Cependant, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) affirme que le risque général pour le grand public est faible.
De l’autre côté de la frontière, une épidémie incessante de grippe aviaire a contraint les éleveurs américains à abattre plus de 150 millions d'oiseaux au cours des trois dernières années. Ces pertes dévastatrices ont provoqué des fissures dans la production américaine d'œufs, ce qui a entraîné une pénurie et une hausse du prix des œufs dans les épiceries américaines.
Un décès dû à la grippe aviaire a été signalé aux États-Unis en janvier dernier: il s'agissait d'une personne hospitalisée en Louisiane en raison de symptômes respiratoires graves. Les autorités sanitaires ont déclaré que la personne était âgée de plus de 65 ans, qu'elle souffrait de problèmes médicaux sous-jacents et qu'elle avait été en contact avec des oiseaux malades et morts dans un élevage de basse-cour. Elles ont également indiqué qu'une analyse génétique avait suggéré que le virus de la grippe aviaire avait muté à l'intérieur du patient, ce qui aurait pu conduire à une maladie plus grave.
Le virus peut «se propager comme une traînée de poudre»
La grippe aviaire H5N1 s'est largement répandue parmi les oiseaux sauvages, les volailles, les vaches et d'autres animaux. Sa présence croissante dans l'environnement augmente les risques que les gens soient exposés et potentiellement l'attrapent.
Le Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies infectieuses au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), a déclaré que les fermes doivent prendre des «mesures très draconiennes» lorsque le virus est détecté, car «la grippe aviaire peut se propager comme une traînée de poudre et être catastrophique non seulement pour les oiseaux, mais aussi, comme nous l'avons découvert ces dernières années, pour d'autres types de mammifères».
«Il y a des mouvements très contrôlés de toutes sortes d'animaux et d'équipements de cette ferme vers d'autres régions ou vers la ferme. C'est donc une situation très contrôlée, et je pense que c'est l'un des avantages que nous avons au Canada, y compris au Québec, c'est que nous sommes capables de mobiliser une réponse rapide pour contrôler les épidémies lorsqu'elles se produisent dans les fermes et, jusqu'à présent, nous avons eu beaucoup de chance», a-t-il déclaré à CTV News.
M. Vinh explique qu'il y a actuellement deux souches du virus qui sont préoccupantes: la souche B3.13, qui se propage à d'autres mammifères, et la souche D1.1, qui peut se propager à d'autres mammifères; chez l'homme, elle est «plus préoccupante».
Tant que les autorités n'auront pas une meilleure maîtrise de la situation au Québec, elles disent qu'elles ne peuvent pas penser que «la barrière des espèces est ce qui va protéger les humains. Je pense que nous pouvons oublier cette idée», a ajouté Vinh.
«Nous avons mis en place des mesures d'atténuation, mais nous ne pouvons pas prétendre qu'elles vont nous protéger indéfiniment.»
Grippe aviaire: les consignes du MAPAQ
- Éviter tout contact direct ou indirect entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages;
- Éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture ou de plans d’eau à proximité du poulailler;
- Limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement; s'assurer que ces personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur;
- Nettoyer et désinfecter les véhicules à moteur avant leur entrée sur les lieux d’élevage;
- Éviter tout lien entre les petits élevages d’oiseaux et les élevages commerciaux;
- Éviter les rassemblements d’oiseaux.
Avec de l'information de Joe Lofaro et de Caroline Van Vlaardingen pour CTV News, ainsi que de La Presse canadienne et de The Associated Press.