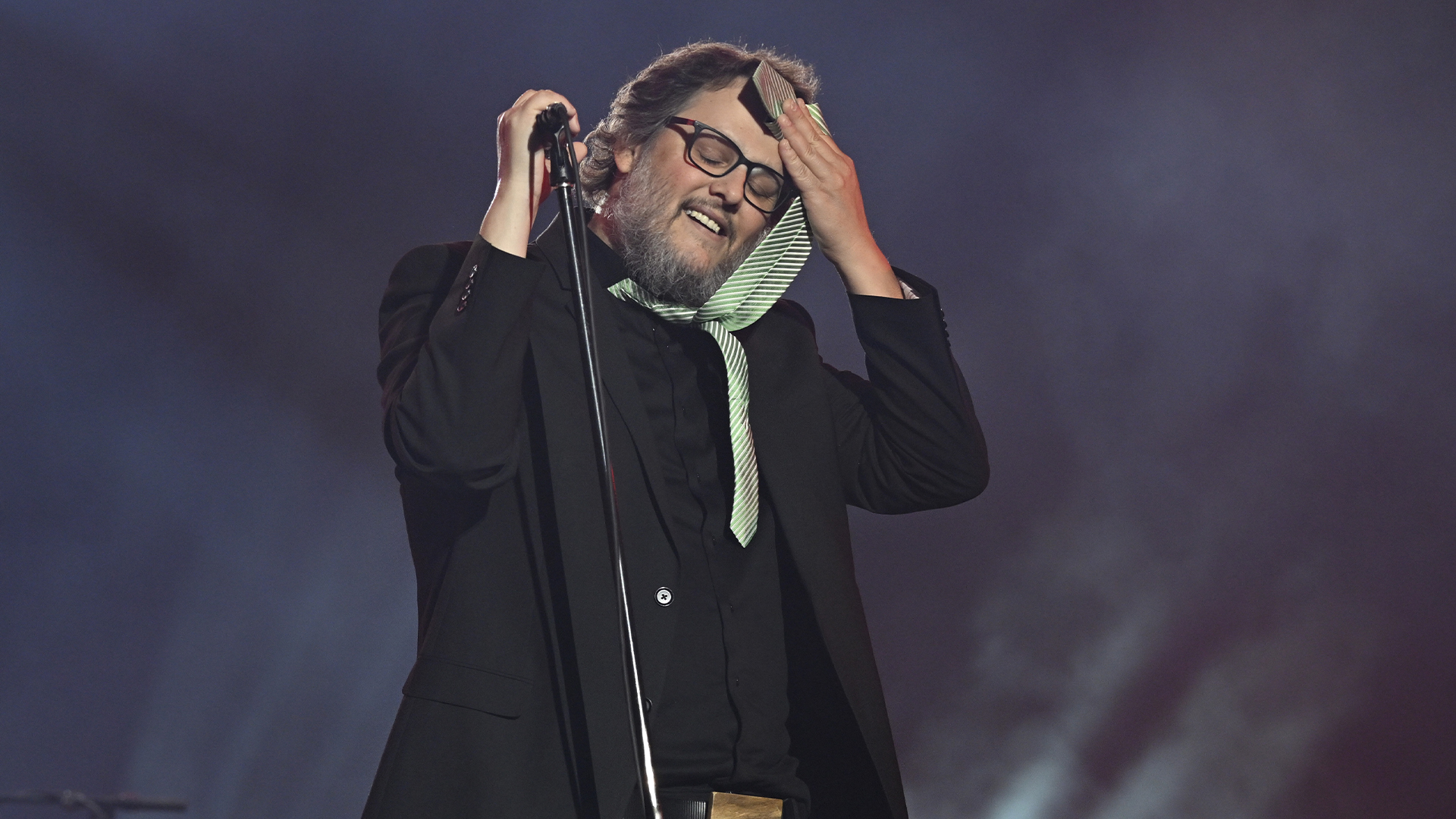Début du contenu principal.
Les plateformes de «streaming» devront financer le contenu canadien à hauteur de 5%, tranche le CRTC
La mesure est censée ajouter 200 millions $ en soutien à la télé, à la radio et aux services de nouvelles locaux.

Les services de diffusion en continu (streaming) devront partager 5% de leurs revenus canadiens pour financer du contenu local, a décidé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
«Ces obligations entreront en vigueur au début de l’année de radiodiffusion 2024‑2025 [le 1er septembre, NDLR] et fourniront un nouveau financement estimé à 200 millions $ par an», a écrit le CRTC dans un communiqué diffusé mardi.
Cette somme ajoutée au portefeuille de l'industrie est censée venir en soutien à la radiodiffusion canadienne, aux nouvelles locales, à la radio, à la télévision, le contenu en langue française et le contenu autochtone, notamment. Cette mesure s'inscrit dans la foulée de la législation C-11 qui vise à moderniser la Loi sur la radiodiffusion.
«La décision d’aujourd’hui fera en sorte que les services de diffusion continue en ligne contribuent de façon importante au contenu canadien et autochtone», a commenté Vicky Eatrides, présidente du CRTC.
Les entités responsables de payer seraient des entreprises qui ne sont pas affiliées à un radiodiffuseur canadien et qui gagnent 25 millions $ ou plus grâce à la radiodiffusion canadienne, ce qui inclut des plateformes comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video.
Les télédiffuseurs traditionnels contribuent déjà à la production de contenu canadien, et cette nouvelle directive vise à créer des règles du jeu équitables entre les géants de la technologie et les télédiffuseurs canadiens.
L'organisation a choisi de redistribuer les contributions des services de diffusion en continu à travers des canaux qui existent déjà, comme le Fonds des médias du Canada et le Fonds canadien de la radio communautaire.
Le montant annuel estimé à 200 millions $ est «plutôt substantiel» et représentera de «bons investissements», a déclaré la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, en se rendant à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres. Elle s'est donc réjouie des suites qui sont données à C-11, dossier qu'elle a chapeauté lorsque l'initiative était au stade de projet de loi.
«Ça va tout à fait dans ce sens de la loi, c'est-à-dire de créer un système qui est équitable, qui permet au Québec, au Canada, d'avoir les moyens de sa production, de s'assurer aussi que ceux qui bénéficient du contenu participent à la création de contenu», a-t-elle dit.
Les libéraux de Justin Trudeau promettaient de longue date de moderniser la Loi sur la radiodiffusion et l'étape de la réglementation passée lundi est venue concrétiser les choses. Avant Mme St-Onge, le dossier a été porté par les prédécesseurs de celle-ci, Pablo Rodriguez et Steven Guilbeault, au cours des dernières années.
Les différents paliers gouvernementaux légifèrent pour tenter d’aider des industries de contenu local qui battent de l’aile au pays. Au Québec, le gouvernement Legault prévoit présenter un nouveau projet de loi au cours de l'année prochaine afin d'obliger les géants de la diffusion en ligne à ajouter davantage de médias québécois sur leurs plateformes.
Il s'agit de l'une des neuf mesures dévoilées en avril, dans le cadre du plan de la province visant à dépenser 603 millions de dollars (M$) sur cinq ans pour protéger la langue française au Québec.
Avec de l'information de La Presse canadienne et de CTV News.