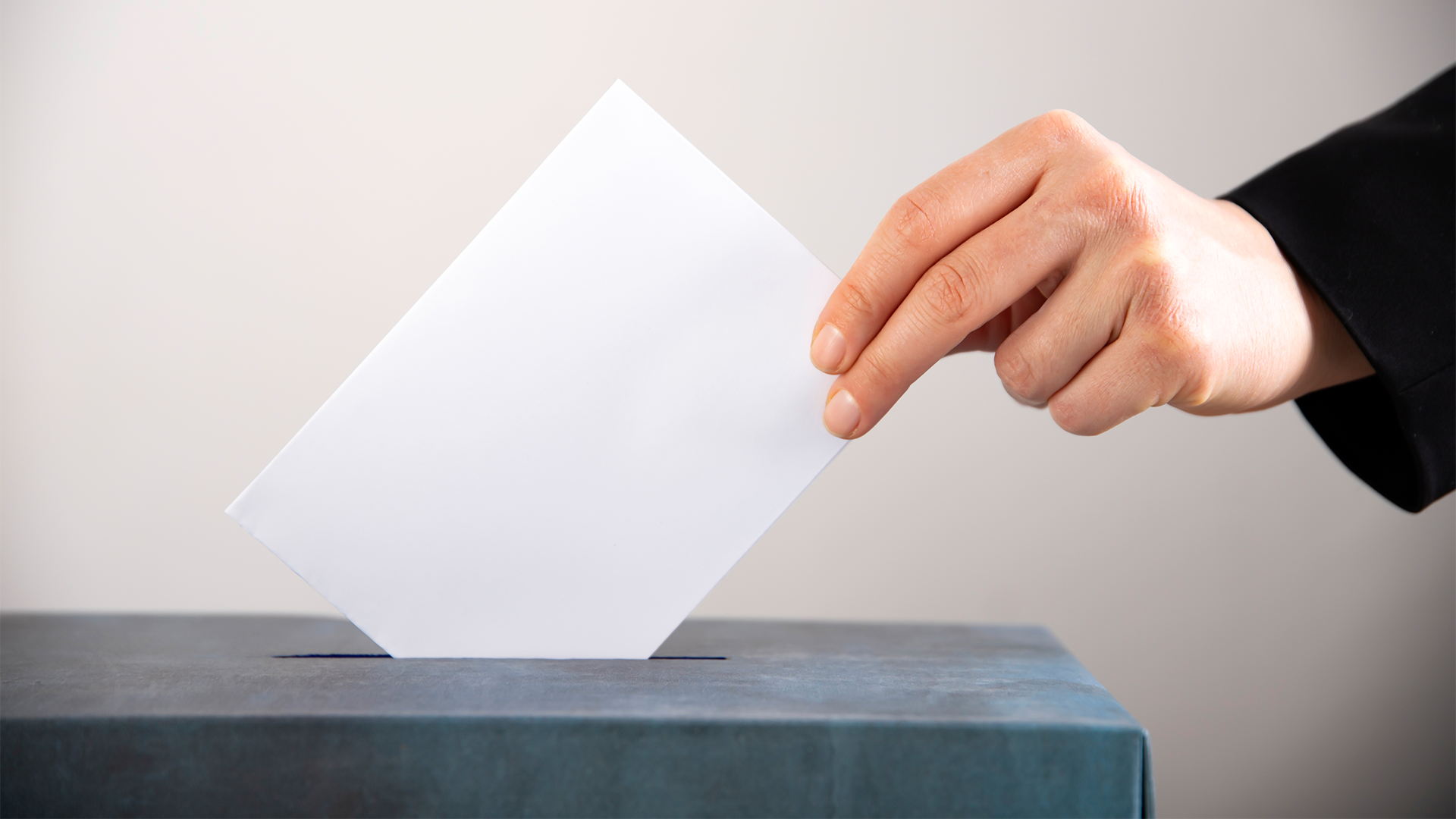Début du contenu principal.
Victor Henriquez | Élections et promesses : un mal/bien nécessaire
Mais pourquoi, alors que nous sommes exposés à une quantité d’informations astronomiques et qu’il est difficile de tout retenir, les partis prennent-ils autant d’engagements ?

L’élection 2022 suit son cours et jour après jour, nous sommes témoins d’une floppée d’annonces et d’engagements de toute sorte. Inflation, santé, éducation, agriculture, fiscalité, famille et tant d’autres sujets sont abordés sous l’angle d’annonces et d’engagements électoraux.
Fait intéressant à noter, en 2018, François Legault avait 251 promesses électorales selon le Polimètre de l’Université Laval. En comparaison, Pauline Marois en 2012 avait 113 promesses, Philippe Couillard en avait 158 et Doug Ford en avait 219 à la dernière élection en Ontario.
Mais pourquoi, alors que nous sommes exposés à une quantité d’informations astronomiques et qu’il est difficile de tout retenir, les partis prennent-ils autant d’engagements ?
Illustrer leur vision
Les engagements électoraux ont d’abord pour objectif d’illustrer la vision d’un parti dans la réalité quotidienne des Québécoises et des Québécois. De cette façon, on s’assure de toucher les publics directement concernés et on donne des raisons concrètes aux gens de voter pour l’un ou l’autre des partis. Il est certain que tous les citoyens ne regardent pas toutes les promesses cependant, lorsqu’une proposition peut modifier notre réalité, que ce soit de façon avantageuse ou pas, nous allons tous avoir tendance à y accorder plus d’attention.
À cet effet, les partis ont multiplié les parutions d’engagements électoraux sur les réseaux sociaux et j’ose espérer que les stratégies de ciblage leur permettent d’offrir une certaine personnalisation de ce qui est présenté aux différents citoyens.
Rythmer et nourrir la campagne électorale
Les engagements électoraux et les annonces qui s’y rattachent permettent également de donner une structure et un rythme à la campagne. Tous les jours, les partis promeuvent un thème en particulier auquel ils rattachent des annonces précises et ce, dans un contexte de tournée qui s’y prête. Journée de l’agriculture dans une ferme au Saguenay pour l’un, immigration dans une entreprise manufacturière en manque de main-d’œuvre pour l’autre et ainsi de suite. En établissant la thématique, les endroits que l’on visite, les annonces que l’on y fera et les candidats que l’on veut mettre en valeur, on donne une certaine homogénéité à la campagne et on s’assure d’une couverture médiatique quotidienne.
De plus, les engagements nous donnent du contenu pertinent à partager sur les réseaux sociaux des partis dans un contexte de multiplication des canaux utilisés et d’amélioration des capacités de ciblage pour les organisations politiques.
Des engagements qui se réalisent
Bien qu’il y en ait beaucoup et que l’on est de la difficulté à s’y retrouver parfois, la bonne nouvelle est que les partis remplissent majoritairement leurs engagements. Comme l’indique le Polimètre de l’Université Laval, ce sont 80 % des promesses qui ont été partiellement ou entièrement réalisées par les deux derniers gouvernements. Même le gouvernement de madame Marois qui était minoritaire et a duré 16 mois avait partiellement ou entièrement réalisé 50 % de ses engagements.
Il y en a peut-être trop, mais avec un taux de réalisation de 80 % les engagements électoraux sont importants dans une campagne et sont certainement là pour de bon. D’ailleurs, je vous invite à aller regarder ceux des partis qui attirent votre attention, ça vous permettra de savoir de quoi auront l’air les 4 prochaines années.
Une courte réflexion à propos d’immigration vs immigrants
Depuis quelques jours, le débat sur l’immigration est très présent dans la campagne. L’immigration est un levier économique, politique et social. Un processus normé que l’on peut améliorer et sur lequel les débats sont essentiels, notamment au sujet des investissements que l’on fait en francisation, reconnaissance des diplômes et régionalisation.
Malheureusement, certaines déclarations « maladroites » ou des expressions comme « compatibilité civilisationnelle » ont tendance à cibler les immigrants comme « fautifs » dans plusieurs débats linguistiques ou identitaires. En tant qu’immigrant, fils de réfugié devenu fier québécois, je trouve blessant ces jugements sur ce que les immigrants viennent faire au Québec.
Les immigrants, ce sont les gens très majoritairement bien intentionnés qui font le choix du Québec pour des raisons nobles et qui ne demandent qu’à réussir, s’intégrer, contribuer et voir leurs racines s’étendre ici. On s’est longtemps vanté, au Québec, d’avoir des débats non partisans sur l’immigration. Nous devrions, peut-être, continuer sur cette voie ?