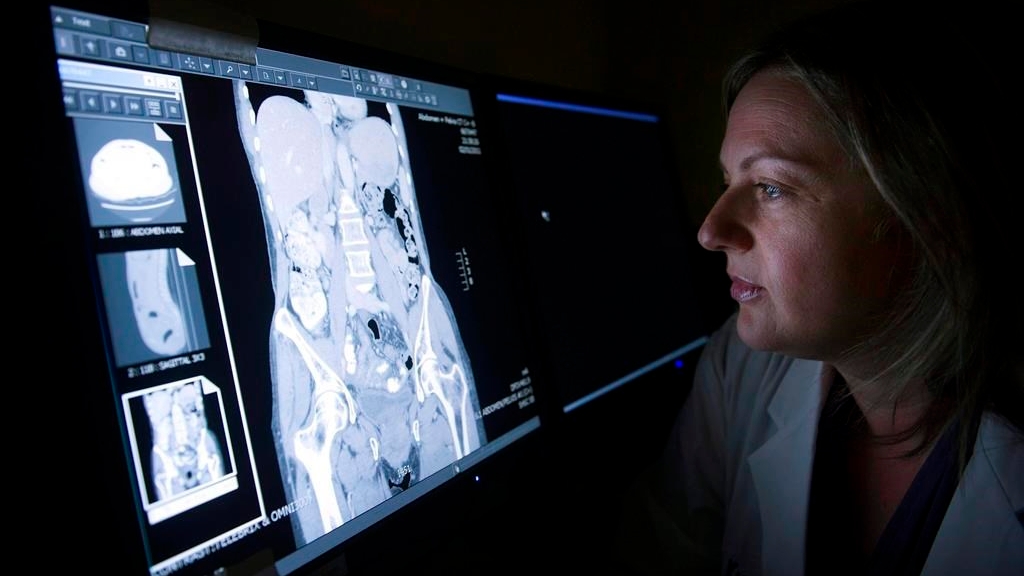Début du contenu principal.
Situation dans les urgences: Montréal et le 450 sous forte pression
En date de ce vendredi avant-midi, le taux d'occupation moyen des urgences du Québec était établit à 121%, selon les données d'Index Santé.
Sans grande surprise, les urgences du Québec sont toujours sous pression alors que nous arrivons tout près du coeur de la présente période hivernale, affirme vendredi Santé Québec dans son troisième bilan de la situation des urgences au Québec.
Pour la période du 7 au 20 janvier dernier, le taux d'occupation sur civière est passé de 122% en 2023-2024 à 121% en 2024-2025, donc une très légère baisse de 1%.
Voyez le reportage de Lila Mouch dans la vidéo ci-haut.
Au cours de cette même période, la durée moyenne de séjour est passée quant à elle de 20,1 heures à 19,5 heures, «soit une amélioration de 35 minutes par patient».
À voir aussi | Hôpitaux débordés au Québec: les maladies et virus qui ne nécessitent pas un voyage à l'urgence
Forte pression à Montréal et dans le 450
Santé Québec a précisé lors de son point de presse que du 7 au 20 janvier dernier, les régions de Montréal ainsi que celles de Laval, Laurentides, Lanaudière et la Montérégie (soit la région du 450) ont connu une augmentation significative du nombre de visites dans les urgences, de 9,2% et de 6,7% respectivement.
Pour Montréal, le tout représente, par jour, plus de 200 visites supplémentaires, comparativement à la même période l’an dernier. Cette pression supplémentaire sur les urgences explique notamment l’évolution du taux d’occupation.
Selon une employée qui travaille aux urgences du CHUM rencontré par Noovo Info, les urgences sont souvent remplies de personnes en situation d’itinérance et de toxicomanes.
«C’est décourageant», déplore-t-elle.
«Avec cette population (de personnes en situation d’itinérance), c’est très difficile pour les urgences parce qu’ils trainent leur "maison" avec eux», a indiqué Nathalie Moreau, présidente de l’APTS au CHUM.
Une réalité qui influence l’affluence hospitalière selon le syndicat, mais pour Santé Québec la hausse du taux d’occupation a plusieurs causes, excluant celle de la présence des personnes en situation d’itinérance.
«Cette augmentation des visites peut s'expliquer notamment par les besoins et la complexité de la clientèle montréalaise. Les usagers qui se présentent à l'urgence sont souvent plus malades, plus âgés et ils ont des besoins plus complexes», a déclaré Véronique Wilson, directrice générale adjointe à la coordination réseau et au soutien aux opérations chez Santé Québec.
«Ces usagers se retrouvent donc plus souvent couchés sur une civière et demandent qu'on prenne du temps pour bien les soigner, ce qui augmenter le taux d'occupation sur civière.»
Mme Wilson a aussi fait valoir que les hôpitaux spécialisés, notamment le CHUM, le CUSM, l'Hôpital général juif, l'Hôpital Sacré-Cœur et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, desservent une clientèle qui habite à l'extérieur de la métropole. Les patients de l'extérieur dépassent parfois les 30 % de la clientèle de ces hôpitaux.
À la demande de Santé Québec, plusieurs hôpitaux de la province ont d'ailleurs mis en place des plans pour augmenter temporairement la capacité hospitalière de leur milieu, hors de l'urgence.
«Nous sommes conscients de l’impact de la surcapacité sur le personnel des unités de soins, mais notre travail est d’équilibrer la pression sur les étages et à l’urgence, tout en maintenant des soins et services sécuritaires pour tous les patients, et ce peu importe où il se trouve dans le réseau», a expliqué Véronique Wilson.
Au 17 janvier, 634 lits supplémentaires avaient été ouverts temporairement au Québec dont 248 pour la région de Montréal et 249 pour les régions de Laval, Laurentides, Lanaudière et la Montérégie.
«Pas en perdition»
Dressant l'état de la situation des virus qui incommodent actuellement plusieurs Québécoises et Québécois, le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique du Québec, a voulu être rassurant. «Nous ne sommes pas en perdition, on a déjà connu pire», a-t-il souligné.
Le Dr Boileau a indiqué que le pourcentage de tests positifs de la COVID-19 était en baisse. «Ça va dans le bon sens en ce moment. Il y a des nouveaux variants, mais ils ne sont pas plus dangereux que les autres variants que nous avons eus et la vaccination est efficace», a-t-il expliqué.
Le VRS (virus respiratoire syncytial) semble aussi être en baisse. «Nous avons donné 43 000 doses de produits immunisants aux nouveau-nés et nous avons beaucoup moins d'hospitalisations chez les jeunes enfants», a noté M. Boileau.
À lire également
La santé publique demeure toutefois vigilante en ce qui concerne le virus de l'influenza alors que le pourcentage de tests positif au virus est en augmentation et qu'on s'attend à ce que ça continue un peu. «On devrait avoir un pic au début de février qui ne va pas chuter immédiatement, il va baisser graduellement», a expliqué le Dr Boileau.
Au Québec, entre 6 000 et 7 000 personnes sont hospitalisées chaque année en raison de l'influenza, dont quelques centaines aux soins intensifs. Le virus contribue également, malheureusement, à plusieurs décès.
Le Dr Luc Boileau a aussi mentionné que le Québec connaît sans doute «une année exceptionnelle» en ce qui concerne la «gastro». «Pour s'en sortir, il faut se laver les mains souvent, avec du savon, et s'isoler des autres quand nous sommes malades», a-t-il mentionné.
En ce qui concerne la rougeole, le Dr Boileau a affirmé que la maladie demeure préoccupante et qu'une éclosion était «sous surveillance» à l'heure actuelle.
Le directeur national de santé publique du Québec a tenu à réitérer les bienfaits de la vaccination face aux virus, dont ceux d'hiver, au Québec. «Ce faire vacciner aujourd'hui, ça reste pertinent, ça réduit les risques», a-t-il affirmé.
«Bien que la situation soit sous contrôle, nous suivons de près l’évolution de la circulation des virus. Lorsque celle-ci augmente, ses effets se font rapidement ressentir sur le réseau de la santé. Il est important de protéger les personnes vulnérables, qui sont plus à risque de développer des complications et de se retrouver à l’hôpital. Chacun doit faire des efforts, en surveillant ses symptômes, en se lavant fréquemment les mains et en profitant de l’offre de vaccination», a conclu le Dr Boileau.
Taux d'occupation et temps d'attente
En date de ce vendredi avant-midi, le taux d'occupation moyen des urgences du Québec était établit à 121%, selon les données d'Index Santé.
La durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) était de 4 heures 39 minutes alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) était de 18 heures 31 minutes.
Le Québec comptait 613 patients sur civière depuis plus de 24 heures et 190 patients sur civière depuis plus de 48 heures.
Régions du Québec où le taux d'occupation est égal ou supérieur à 100% (24 janvier, avant-midi) :
- Laval - 173%
- Laurentides - 156%
- Montréal - 144%
- Montérégie - 140%
- Outaouais - 135%
- Chaudière-Appalaches - 124%
- Mauricie et Centre-du-Québec - 109%
- Abitibi-Témiscamingue - 105%
- Lanaudière - 104%
- Capitale-Nationale - 103%
Avec des informations de La Presse canadienne.