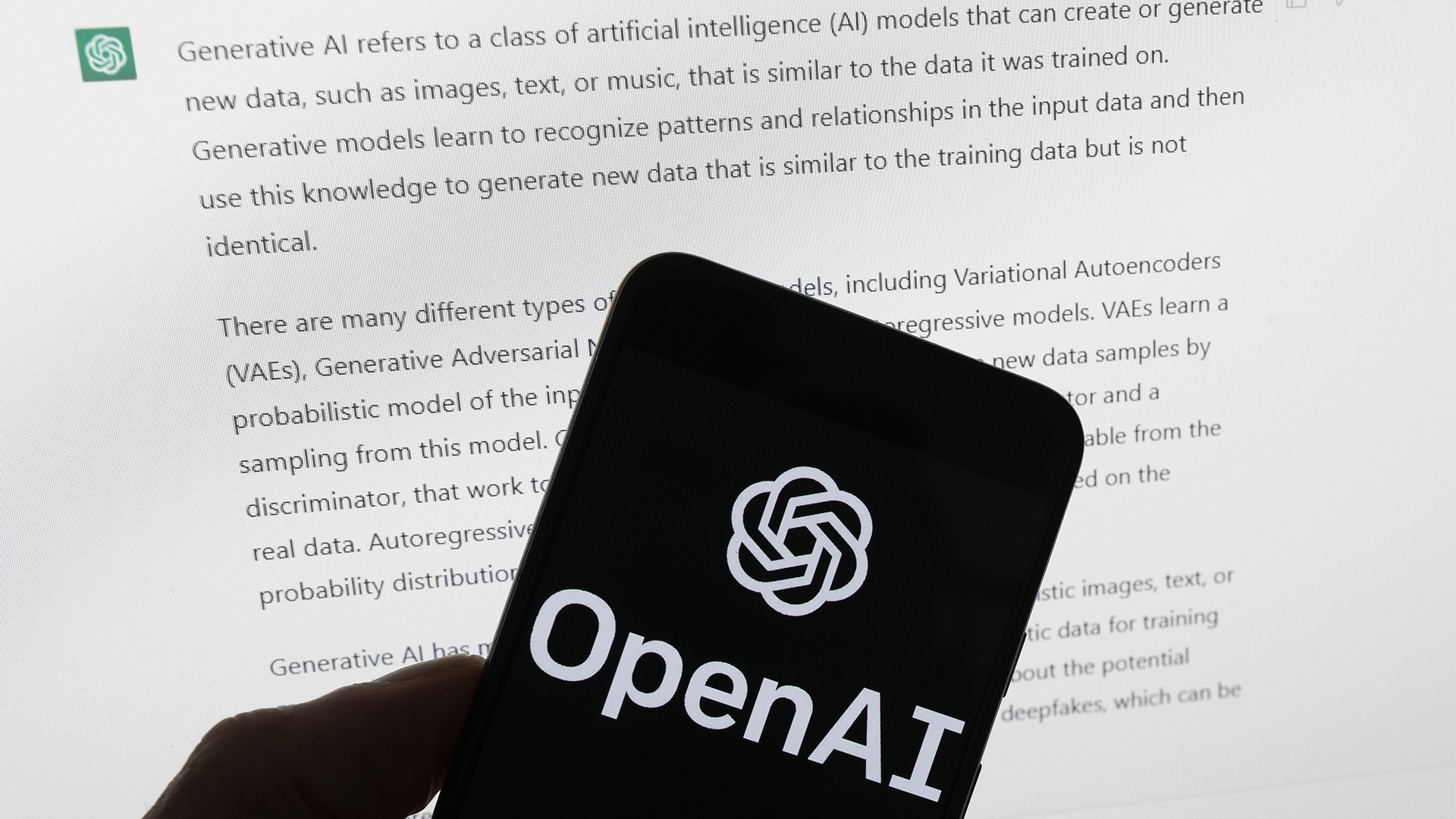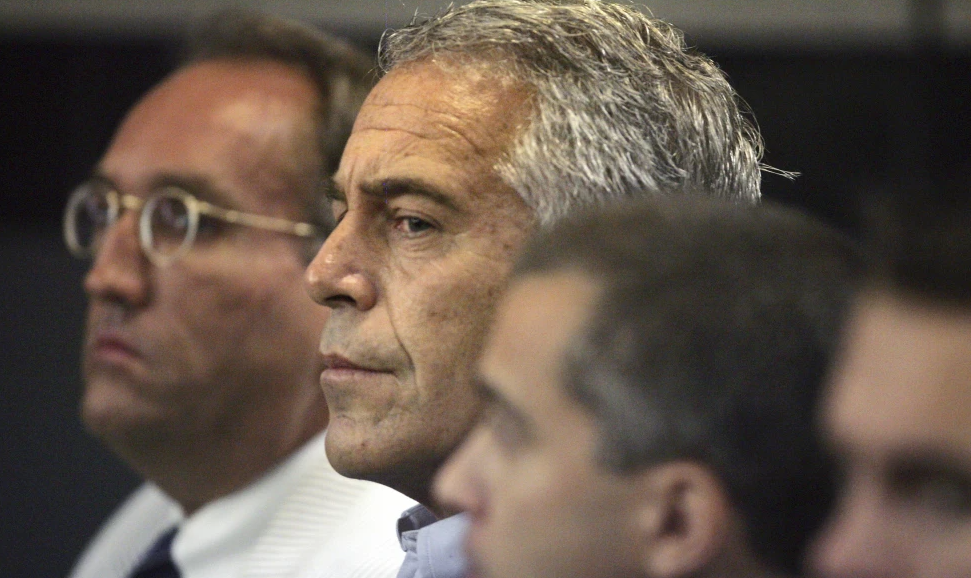Début du contenu principal.
La population québécoise doute de la crédibilité des victimes d'agression sexuelle, révele une étude
État des lieux du consentement sexuel au Québec.
La population québécoise remet en question la crédibilité des victimes d'agression sexuelle, selon une étude de l'UQAM. Les résultats montrent que face au consentement sexuel, les femmes sont plus nombreuses à exprimer des attitudes positives, tandis que les hommes ont davantage des positions moins favorables.
On apprend aussi qu'une majorité d'hommes ne rejettent pas totalement l'idée qu'une femme qui initie des baisers ou des caresses ne devrait pas être surprise si un homme en conclut qu’elle veut avoir une relation sexuelle.
La Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a collaboré avec l’Université du Québec en Outaouais (UQO) sur le projet de recherche intitulé «Interroger la complexité du consentement sexuel chez la population québécoise de 15 ans et plus». Les résultats ont été présentés mercredi matin.
Ils suggèrent que la notion de consentement n'est pas acquise par de nombreux Québécois. Pour plus d'une personne sur trois, si votre partenaire veut s'engager dans une activité sexuelle, c'est correct de procéder même si la personne est ivre. Autre fait saillant, le quart des participants est en accord ou neutre par rapport à l'idée qu'il est parfois correct de ne pas du tout demander le consentement sexuel .
À lire également
Au total, 1222 personnes âgées de 15 ans et plus ont participé à l'étude en répondant à un questionnaire en ligne. Le sondage a été réalisé du 11 novembre au 8 décembre 2024.
La coautrice du rapport Ihssane Fethi rappelle qu'il n'y a pas de consentement quand une personne est ivre, intoxiquée ou qu'il y a des pressions sexuelles.
Les chercheuses qui ont mené l'étude ont été soulagées de voir que certains aspects positifs se dégageaient de leur travail. Pour 92 % des répondants, le consentement sexuel devrait toujours être obtenu avant le début de toute activité sexuelle.
«On pourrait dire que c'est superbe de façon générale, les attitudes sont favorables dans la population québécoise. Le consentement est important, mais quand on creuse dans certaines situations spécifiques, surtout les situations où il ne peut pas y avoir de consentement, c'est encore perçu quand même par une partie de la population comme étant quelque chose d'acceptable, de correct. Et c'est ce décalage qui doit nous interpeller tous ensemble», a commenté en conférence de presse Mme Fethi.
Une culture du viol existe au Québec
Par rapport aux violences sexuelles, de nombreux mythes persistent, montrent les résultats du sondage. On apprend que 77 % des hommes et 53 % des femmes ne rejettent pas totalement l’idée selon laquelle «les accusations d’agression sexuelle sont souvent utilisées comme une façon de se venger des hommes».
Les trois quarts des hommes et 67 % des femmes ne rejettent pas totalement l'idée que «les hommes n’ont généralement pas l’intention de forcer une femme à avoir une relation sexuelle, mais parfois, ils s’emportent trop sexuellement».
De plus, 86 % des hommes et 67 % des femmes pensent que «parfois, les femmes qui disent avoir été agressées sexuellement ont accepté d’avoir une relation sexuelle et l’ont ensuite regretté».
«Ce qui est important de réaliser, c'est qu'une adhésion même faible à des mythes demeure préoccupante parce que l'adhésion à ces mythes va venir façonner les perceptions de la population sur ce qu'est une agression sexuelle, qui peut être cru, qui doit être tenu responsable d'une agression sexuelle», souligne la coautrice et experte en violence sexuelle, Karine Baril.
Elle mentionne que les données viennent pointer qu'il existe une culture du viol au Québec, «quoi qu'on en pense».
«Le fait qu'une proportion importante de la population ne rejette pas différents mythes, qui sont des croyances erronées, simplistes et qui sont préjudiciables pour l'ensemble de la population, montre bien qu'on a encore du travail à faire et que la situation n'est pas réglée», conclut Mme Baril.
«J’ai l’impression qu’on dit les mêmes choses qu’il y a un siècle ou qu’il y a 50 ans et qui font en sorte que la population ne semble pas encore prête à éviter de blâmer les victimes et éviter de discréditer la parole des femmes», mentionne Sandrine Ricci, chercheuse et candidate au doctorat en sociologie et en études féministes à l’UQAM, en entrevue avec Noovo Info.
Les résultats présentés mercredi sont préliminaires et d'autres analyses sont prévues et seront diffusées ultérieurement.
Variations selon les groupes d'âge
Selon les données, les jeunes de 15 à 25 ans et le groupe des 66 ans et plus adhèrent davantage à plusieurs mythes, particulièrement ceux qui remettent en question la crédibilité des victimes et les mythes qui minimisent l'intention de l'agressant.
Le niveau de scolarité semble aussi avoir une influence. Les personnes avec un diplôme d'études secondaires ou une formation professionnelle ont tendance à adhérer de façon significativement plus élevée à ces mythes et préjugés que les universitaires ou les personnes avec un diplôme du cégep, a précisé la coautrice Dominique Trottier.
Elle y voit un lien avec la montée du discours masculiniste, soulignant que les mythes les plus endossés sont ceux qui font écho à des atteintes de genre. `Donc, c'est pas pour rien que les mythes les moins rejetés par les hommes, entre autres, sont ceux qui les déresponsabilisent par rapport à la question des intérêts sexuels', soulève la chercheuse.
«On a tendance à croire que, de génération en génération, on évolue, nos pensées évoluent, nos croyances évoluent et changent, alors qu'on se rend compte, finalement, que ce sont des tendances qui vont osciller à travers le temps et à travers les époques», ajoute-t-elle.
Sa collègue Mme Baril reconnaît que le mouvement MoiAussi a certes fait évoluer le débat, mais elle pense qu'il y a probablement un contrecoup au fait de discuter dans l'espace public d'agression sexuelle comme ce fut le cas avec le contexte MoiAussi. `On a pu alimenter certains mythes et préjugés en même temps que la situation s'est améliorée, mais on ne peut que prétendre. Il faudra faire d'autres enquêtes ultérieures avec la même méthodologie pour pouvoir le montrer', dit-elle.
D'ailleurs, les résultats présentés mercredi sont préliminaires et d'autres analyses sont prévues et seront diffusées ultérieurement.